Par un bibliophile français, membre de la Guilde des Bibliopolicés, et membre imaginaire de la Société des Amis du Livre
Amis bibliophiles, bonjour,
« Une bibliothèque bien composée est une galerie de portraits moraux ; c’est l’âme des siècles précieusement conservée. » écrivait Octave Uzanne en 1888 dans Le Miroir du Monde. Cette formule dit tout de l’esprit qui anima la bibliophilie française au XIXᵉ siècle, âge d’or d’une passion transfigurée. Après les bouleversements révolutionnaires, la France vit émerger une génération d’amateurs éclairés qui, dans leurs cabinets feutrés ou leurs salons bruissant de conversations érudites, redéfinirent l’art de collectionner. Plus qu’un simple goût, ce fut une véritable renaissance du culte du livre, un art de vivre autant qu’un acte de résistance à l’industrialisation croissante de l’imprimé.
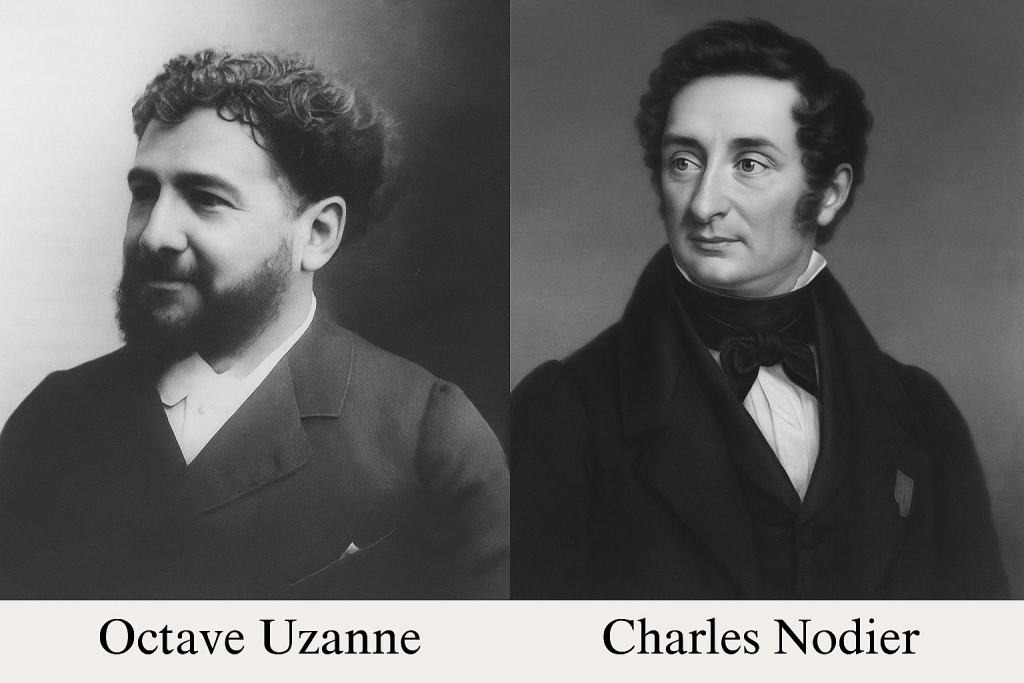
Héritiers des Lumières et enfants du romantisme
La Révolution avait dispersé les grandes bibliothèques aristocratiques ; les ventes publiques de la fin du XVIIIᵉ et du début du XIXᵉ permirent aux nouveaux amateurs de constituer leurs collections. Ceux-ci n’étaient plus des princes fastueux ou des prélats fortunés, mais des hommes de loi, des écrivains, des hauts fonctionnaires ou de riches bourgeois. Le livre devint à la fois instrument de distinction sociale et refuge intime.
Charles Nodier en incarne le modèle le plus éclatant. Ce romantique fervent, bibliothécaire de l’Arsenal, réunit autour de lui un cénacle où se pressaient jeunes poètes, artistes et érudits. On y respirait l’odeur du vieux maroquin et l’on y célébrait l’édition originale des grands textes modernes : Hugo, Lamartine, Musset. Nodier n’aimait pas seulement les livres, il savait les faire aimer, et sa passion pour les exemplaires rares marqua durablement la sensibilité bibliophilique française.
Dans son sillage se formèrent les premières sociétés bibliophiliques structurées : la Société des Bibliophiles français, fondée en 1820 autour de Nodier à la bibliothèque de l’Arsenal, avec la participation de grands érudits comme Antoine-Augustin Renouard. Le libraire-éditeur Joseph Techener, bien qu’il n’en soit pas le fondateur, y prit rapidement place et y joua un rôle de premier plan. Plus tard vinrent les Cent Bibliophiles (1874), les Amis des Livres (1874) et les Bibliophiles contemporains (1889), autant de cercles où l’on échangeait tirages de luxe et éditions restreintes, souvent accompagnées de gravures originales.
Les artisans d’un goût nouveau : libraires, imprimeurs et relieurs
La bibliophilie du XIXᵉ ne saurait être comprise sans les figures de passeurs que furent les libraires et imprimeurs spécialisés. Joseph puis Léon Techener donnèrent à leur maison du Palais-Royal une aura considérable, rééditant des textes rares en tirages élégants. Damase Jouaust, quant à lui, fondateur de la Librairie des Bibliophiles, fit revivre l’esprit des Elzéviers, ressuscitant l’art du petit in-octavo raffiné et soigné. Ambroise Firmin-Didot, héritier d’une dynastie typographique, poussa plus loin encore la recherche de perfection matérielle, publiant de splendides éditions illustrées et se passionnant pour l’histoire de l’imprimerie.
Aux côtés de ces éditeurs, les relieurs donnèrent au XIXᵉ siècle certaines de ses plus hautes réussites. Trautz-Bauzonnet, Lortic, Chambolle-Duru, Marius-Michel rivalisèrent de virtuosité. Leurs reliures mosaïquées, leurs dos richement ornés, leurs doublures de soie ou de maroquin firent de chaque volume une œuvre d’art unique. Le bibliophile ne se contentait pas d’acquérir : il commandait, il transformait, il « habillait » son livre comme un aristocrate habille un invité d’honneur. Le livre devint ainsi le miroir du goût personnel, parfois jusqu’au maniérisme.
Figures emblématiques : collectionneurs et érudits
Aux côtés de Nodier et d’Uzanne, une pléiade d’amateurs marqua le siècle. Ernest Quentin-Bauchart, demeure l’un des érudits les plus remarqués de son temps. Eugène Paillet, magistrat et collectionneur, rassembla des incunables et des éditions gothiques, affirmant la continuité d’un intérêt pour le Moyen Âge. Paul Gallimard, mécène et ami des impressionnistes, réunit une somptueuse bibliothèque d’illustrés modernes et de manuscrits littéraires, dont la réputation brilla jusque dans les ventes du XXᵉ siècle.
Et comment oublier Paul Lacroix, dit le « Bibliophile Jacob », conservateur de la Bibliothèque de l’Arsenal après Nodier ? Polygraphe infatigable, vulgarisateur de génie, il sut mettre à la portée d’un large public les trésors de l’histoire du livre, tout en cultivant ses propres manies d’amateur. Il affirmait, non sans ironie, que « les livres modernes sont le triomphe du commerce, mais les livres anciens sont le triomphe du goût » — une formule qui résume bien la méfiance d’alors face à la production industrielle envahissant les étals.
Octave Uzanne, l’esthète fin-de-siècle
Nul mieux qu’Octave Uzanne n’incarne la métamorphose de la bibliophilie en art total. Éditeur raffiné, écrivain aux chroniques mordantes, fondateur des Bibliophiles contemporains, il fit collaborer artistes et graveurs de premier plan : Rops, Grasset, Mucha. Ses livres, tirés à très petit nombre, soignés jusqu’au fétichisme, marient texte, illustration et typographie dans un ensemble raffiné, parfois précieusement décadent. Uzanne voyait dans le livre l’équivalent d’un bijou, un objet de luxe destiné à séduire l’œil autant que l’esprit.
Ses Caprices d’un bibliophile ou son Paroissien du célibataire sont autant de manifestes d’une bibliophilie nouvelle, teintée d’humour, d’érotisme feutré et de dandysme. Le bibliophile ne se contente plus de vénérer les grands textes : il s’invente comme créateur, critique, styliste de sa propre passion.
Pratiques et rites de possession
Ce qui distingue la bibliophilie du XIXᵉ, c’est l’importance accordée à la matérialité et à la mise en scène. L’édition originale devient un fétiche : on recherche le premier tirage des grands romantiques, l’exemplaire sur papier de Hollande ou de Chine, lavé, non rogné, enrichi d’un envoi. Les collectionneurs s’attachent aux provenances, aux ex-libris, aux reliures d’époque. Certains vont jusqu’à composer des exemplaires uniques, en réunissant illustrations originales, lettres autographes, gravures intercalées.
La vente publique devient le théâtre privilégié de cette passion. Les catalogues de vente, rédigés avec un luxe de détails, sont eux-mêmes collectionnés, annotés, reliés. Ils forment aujourd’hui une documentation essentielle pour l’histoire des bibliothèques privées. Un bibliophile du XIXᵉ ne se contentait pas d’acheter : il assistait, il commentait, il faisait partie d’une société discrète où chacun observait le goût des autres.
Entre résistance et modernité
Le XIXᵉ siècle est un moment charnière : d’un côté la nostalgie des grandes bibliothèques d’Ancien Régime, dispersées mais toujours rêvées ; de l’autre, la montée en puissance d’un marché moderne, animé par les ventes, les libraires spécialisés et les sociétés bibliophiliques. La production industrielle, avec ses millions de volumes standardisés, suscita chez les amateurs le besoin d’affirmer une contre-culture de l’exception.
Ainsi, tandis que la grande édition populaire triomphait, le bibliophile cultivait la rareté, la singularité, l’ornement. Son geste était en un sens conservateur : sauver le beau livre dans un monde qui tendait à l’homogénéité. Mais il fut aussi moderniste : par le recours à des illustrateurs contemporains, par le goût des éditions à tirage limité, par l’attention portée à l’objet en tant qu’œuvre d’art autonome.
Héritage vivant
L’influence des bibliophiles du XIXᵉ siècle demeure aujourd’hui tangible. Les grandes institutions publiques — la Bibliothèque nationale de France, la Mazarine, l’Arsenal — doivent beaucoup aux collections dispersées de ces amateurs. Leurs ventes, leurs catalogues annotés, leurs exemplaires enrichis forment une mémoire matérielle que l’historien du livre ne cesse de consulter.
Plus profondément, leur conception du livre comme objet d’art, comme miroir du goût, continue de hanter la bibliophilie contemporaine. L’édition originale, la reliure de créateur, le tirage restreint, l’illustration originale : autant d’exigences qui demeurent vivaces. Et la figure d’Uzanne, toujours redécouverte, rappelle que le bibliophile peut être à la fois érudit, créateur et styliste.
Les bibliophiles français du XIXᵉ siècle ne furent pas de simples amateurs du passé. Ils incarnèrent une renaissance, en élevant le livre au rang d’œuvre d’art et en affirmant, face à la standardisation, la primauté du goût et de la rareté. Ils furent des héritiers, certes, mais aussi des inventeurs. Leur legs n’est pas seulement constitué de reliures somptueuses et d’exemplaires uniques : il réside dans une manière de regarder le livre comme un être vivant, susceptible de refléter l’âme des siècles.
Qu’un jour encore la reliure retrouve sa noblesse, que l’édition originale conserve son prestige, que l’objet-livre garde son aura de mystère et de beauté, et nous pourrons dire que ces poètes du papier n’ont pas collectionné en vain.
Cote de la Guilde : HIST-BIB-19E-001
(Dossier historique sur les bibliophiles français du XIXᵉ siècle)
Laisser un commentaire