Par Alcide Raturon, bibliophile errant et voyageur des temps imprimés.
Amis bibliophiles, bonjour.
Il n’est pas rare que l’on me demande d’éclaircir une zone d’ombre dans l’histoire des livres ; il est plus rare que je sollicite moi-même un compagnon pour franchir les couloirs du temps. Mais cette fois, je savais que je ne pouvais partir seul. Il me fallait l’œil d’un connaisseur, un esprit habitué à débusquer la fine nuance dans l’art typographique, un homme qui savait distinguer le vrai Didot du faux hommage, le rêve d’édition de l’accomplissement typographique. Ce compagnon, je le trouvai sans peine dans notre siècle : Christian L., qu’on nomme Calamar, connaît les Didot comme peu d’autres, et sa curiosité en fait un compagnon idéal, fût-ce pour un voyage dans le temps.
Je le rencontrai à la tombée du soir, dans le calme d’une bibliothèque moderne. La lumière des néons, presque froide, contrastait avec la chaleur feutrée des volumes anciens disposés derrière lui. Christian feuilletait un catalogue de ventes où brillaient des reliures en maroquin rouge, et son doigt s’attardait sur la description d’un Virgile imprimé par Didot en 1798. Je lui parlai d’un feuillet retrouvé dans les archives de la Guilde, mentionnant un Cicéron que Pierre Didot aurait voulu imprimer « selon la perfection de ses Racine et de ses Fables ». L’ouvrage, annoncé comme devant compléter la série monumentale, n’a jamais paru dans ce format.
« Veux-tu, lui dis-je, aller vérifier cela à la source ? » Il sourit, incrédule, mais son regard s’embrasa. Christian a ce don : il passe du scepticisme amusé à l’enthousiasme ardent en un battement de cil. Quelques instants plus tard, le temps se plia comme une feuille sous le plioir d’un relieur, et nous traversâmes.
Nous nous retrouvâmes dans l’atelier du Louvre, aux alentours de 1802. Le choc des sens fut immédiat. La salle bruissait du vacarme régulier des presses ; le fer grinçait, le bois craquait, l’acier frappait le papier dans une symphonie mécanique. L’odeur d’encre épaisse, de vélin humide et de colle chaude emplissait l’air, si dense qu’on eût pu la découper au coupe-papier. Des hommes en chemise, manches retroussées, tiraient les lourds leviers des presses Stanhope ; d’autres étendaient sur des cordes des feuillets frais qui tintaient comme linge mouillé. Des apprentis, visages tachés d’encre, couraient d’un poste à l’autre avec des casses de caractères.
Christian, saisi, murmura : « C’est donc vrai… je reconnais là les papiers d’Annonay… regarde ces grandes feuilles, encore humides, elles exhalent cette odeur unique, entre le chiffon et la rivière. Et ces casses de caractères… ce sont bien les Didot, je reconnais la fonte, ces pleins et ces déliés. » Sa voix vibrait d’un respect profond, mêlé à une joie tendre qui ne le quittait jamais lorsqu’il parlait des choses du livre.
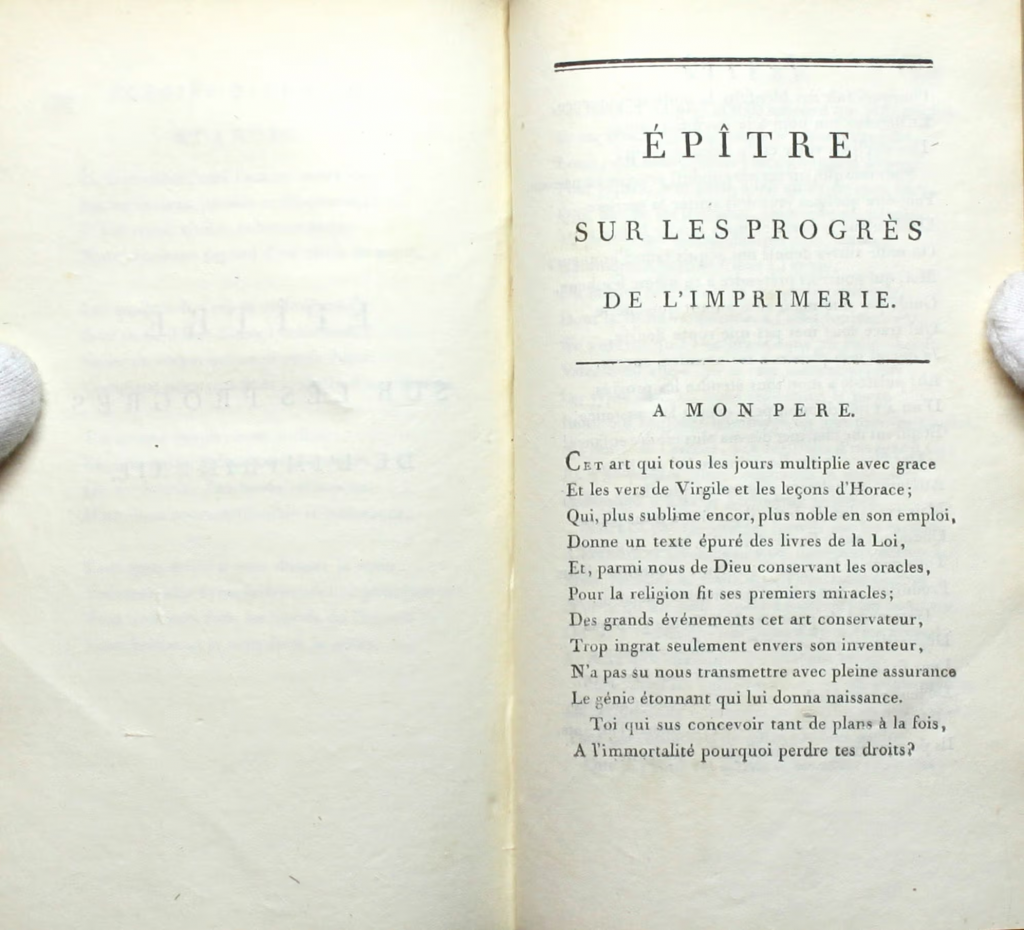
Nous marchâmes parmi les ouvriers, invisibles pour eux comme des fantômes. Je m’attardai devant une pile de vélin vierge, et j’y lus la promesse silencieuse des pages encore à remplir. Christian, lui, détaillait chaque geste, chaque outil : la réglette, la forme, la platine, les balles d’encrage, les linges noirs dont l’odeur tenace imprégnait déjà nos habits.

Au centre de la salle, surveillant tout d’un œil sévère, se tenait Pierre Didot. Il avait la stature grave de ceux qui portent en eux la certitude d’un art et l’inquiétude d’un commerçant. Ses cheveux poudrés contrastaient avec l’éclat vif de son regard. Il maniait tour à tour la règle et la plume, passant de la table de correction au bureau où s’entassaient des comptes. C’était un homme partagé entre l’idéal et l’arithmétique, entre le temple et la boutique.
Nous nous approchâmes. Je pris la parole d’un ton assuré, feignant l’amateur éclairé :
« Monsieur, nous avons entendu parler d’un Cicéron, digne de vos Racine et de vos Fables. Est-ce un simple projet, ou bien existe-t-il déjà quelques épreuves ? »
Didot nous toisa, sur la défensive. « Voilà une curiosité inhabituelle. Qui vous parle de mes projets ? »
Alors Christian, avec un calme respectueux et une pointe d’humour dans la voix, intervint. « Vos Fables de La Fontaine, monsieur, sont à mes yeux le sommet de l’harmonie entre le caractère et l’image. Je n’ignore pas que cinquante-sept planches accompagnaient déjà votre Racine. Vos marges, larges et aérées, ont fixé un canon que beaucoup copieront sans jamais l’égaler. Si vous annonciez un Cicéron, je devine ce qu’il eût été : un monument digne de Rome, un temple de papier. »
Didot se figea, étonné. Ses traits s’adoucirent. « Vous parlez comme un homme qui a feuilleté mes livres. Mais je n’ai point encore publié ce Cicéron. »
Christian répondit doucement : « Justement. Je crois aux livres qui n’existent pas. Ils disent parfois plus sur l’ambition d’un imprimeur que les volumes achevés. Montrez-nous une preuve, un fragment, et nous saurons en mesurer la portée. »
Pierre Didot hésita. Puis, avec un soupir, il ouvrit un carton sur sa table. Nous y vîmes des feuillets composés en in-folio du Louvre, caractères nets et brillants, marges immenses comme des plaines blanches. Une gravure à demi achevée montrait Cicéron, assis dans une chaire de marbre, dictant ses pensées à un jeune scribe, sous des colonnes antiques. Tout respirait la noblesse classique, la promesse d’une éloquence fixée dans l’éternité du cuivre et du vélin.
Christian prit l’un de ces feuillets avec une précaution infinie. Il le caressa du bout des doigts, admirant la régularité de l’impression. Ses mains, un instant, s’attardèrent sur une marge encore légèrement humide. Quand il le reposa, il demeura, dans le blanc de la page, une trace nette : son empreinte digitale, imprimée par l’encre noire du temps. Didot ne remarqua rien. Moi seul vis cette marque ténue, irréfutable, comme si le futur avait scellé sa présence dans un projet avorté.
Nous restâmes encore de longues minutes à converser. Didot, stimulé par les questions précises de Christian, évoqua ses ambitions et ses découragements.
« Croyez-vous, dit-il, que l’on puisse encore bâtir de telles cathédrales de papier ? Les amateurs se lassent, les caisses s’épuisent. J’ai cru, avec Racine et La Fontaine, atteindre l’absolu. Mais on ne vend pas l’absolu comme on vend un almanach. L’époque veut des livres maniables, des éditions à bon marché. Mon rêve se heurte à l’économie. » Sa voix s’était faite lasse, presque douloureuse.
Je lui demandai alors : « Et Bodoni, là-bas à Parme, ne vous stimule-t-il pas ? »
Il eut un léger sourire amer. « Bodoni flatte les princes, et ses éditions sont des cadeaux diplomatiques. Moi, je parle à la nation. Je veux que la France entière, depuis le Directoire jusqu’aux lycées naissants, sache que ses imprimeurs égalent et surpassent l’Italie. Mais la gloire typographique se paye cher : les presses engloutissent des fortunes. »
Christian ajouta : « On vous reprochera peut-être d’avoir promis trop large : vos prospectus parlent de cent volumes par an, de tous les classiques du monde antique et moderne. Vous ne pourrez les donner tous. »
Didot haussa les épaules. « Qu’importe. Promettre, c’est aussi imprimer dans l’imaginaire. Chaque titre annoncé, fût-il jamais paru, est déjà un éclat de ma vision. Le Cicéron que vous mentionnez… peut-être restera-t-il un fantôme. Mais qu’il soit fantôme ne le rend pas moins réel dans l’esprit des bibliophiles. »
Nous quittâmes l’atelier alors que les presses battaient encore comme un cœur mécanique. Le temps se replia, et nous regagnâmes notre siècle. Christian demeurait silencieux, troublé par ce qu’il avait vu et par la confidence qu’il avait arrachée à Didot.
Quelques semaines plus tard, il reçut une enveloppe discrète. À l’intérieur, soigneusement protégé, se trouvait un feuillet en in-folio du Louvre. Dans la marge blanche, à peine perceptible mais indéniable, son empreinte digitale s’y dessinait encore, preuve tangible de notre passage. Il eut d’abord un éclat de rire, mi-tendre, mi-ironique, ce rire qui lui est propre et qui désarme tout. Puis il resta longuement à contempler ce fragment impossible : un morceau d’un livre jamais né, marqué de sa propre main.
Voilà, chers amis, ce que fut notre enquête chez les Didot : non pas la découverte d’un volume manquant, mais la rencontre avec la frontière fragile entre le livre rêvé et le livre imprimé, entre la gloire et l’échec, entre l’idéal de l’art et la réalité du commerce.
Je songe encore à ce carton entrouvert, à ce Cicéron à demi tracé, aux promesses des prospectus qui gonflaient les espérances des bibliophiles du Consulat. Les Didot avaient juré cent volumes, ils en donnèrent dix. Mais dans l’espace entre la promesse et l’accomplissement, entre l’annonce et le silence, naissent ces livres invisibles que nous, voyageurs du temps, savons encore surprendre.
Et désormais, dans une bibliothèque contemporaine, repose un feuillet impossible : l’ombre d’un Cicéron, annoncé comme devant compléter la série monumentale, jamais paru dans ce format, mais touché par la main de mon compagnon.
Cote : BIB. TEMP. – HBE – n°8 / Enquête chez les Didot
ce feuillet est la pièce maitresse de ma bibliothèque ! merci Hugues, pour ce voyage enchanté 🙂